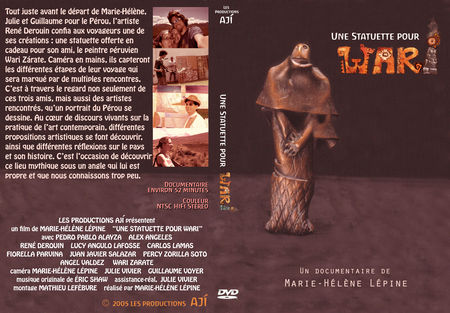Cet article exposera ma sélection personnelle des 10 films sortis en sol québécois entre 2000 et 2010 que je considère comme les dignes représentant de cette décennie.
Pour chaque film, quelques paragraphes vous expliqueront mon choix. Les courts textes iront aux films qui n’ont pas besoin de dissertation, ayant été abondamment défendus par une unanimité journalistique. Bien entendu, les textes les plus longs s’entendront avec les films souffre-douleur mal-aimés, snobés, injustement critiqués. Bref, ces films qui méritent mieux et que j’ai envie de défendre envers et contre tous.
Le Ruban Blanc de Michael Haneke, et Fish Tank de Andrea Arnold, tous deux sortis en 2009 outre-atlantique, auraient dû normalement figurer dans ma liste. Il est d’ailleurs assez incroyable que ces deux chefs-d’œuvre, que je considère comme parmi les meilleurs films qu’il m’ait été donné de voir dans ma déjà longue existence de cinéphile, sortent à quelques semaines d’intervalles en début 2010 au Québec. Je me les réserve donc pour ma prochaine liste, dans 10 ans. Eh oui!
Sans plus tarder (et appuyé de roulements de tambour de préférence), voici cette fameuse liste.
Qu’on ouvre les rideaux!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mon Top 10 des meilleurs films de la décennie 2000
1- A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE (2001) de Steven Spielberg

Ce film, traitant d’un enfant–robot programmé pour aimer sa mère adoptive, marque le début de la période la plus intéressante de la carrière de Spielberg. Pour moi, il s’agit de son chef-d’œuvre. Le film où il trouve l’équilibre parfait entre la verve de sa mise en scène et la puissance de son propos. Rien n’est trop appuyé, et il fait montre d’une retenue qu’on ne lui soupçonnait pas en faisant essentiellement confiance à la force de son scénario (qu’il a d’ailleurs écrit lui-même à partir d’une idée de Stanley Kubrick), et en n’utilisant la virtuosité de sa mise en scène uniquement que pour re-questionner ses effets sentimentaux. En atteignant les sommets de l’épure émotionnelle, il trouve une justesse qui fait froid dans le dos. A.I. est d’une puissance déstabilisante et poétique qui souffle tout sur son passage.
Steven Spielberg a réalisé là son film le plus exigeant. Avec ce film, il a divisé la critique, et déboussolé le public qui l'attendait ailleurs. Certains de ses plus grands fans ont même arrêté de le suivre à partir de ce film. Pourtant, A.I. est du Spielberg à l'état pur. Même si Kubrick est derrière tout ça, A.I. est le film dans lequel Spielberg se livre le plus, peut-être même inconsciemment. Et Kubrick le savait en essayant de le convaincre de prendre les rênes du projet. Le film touche des thèmes chers à Spielberg (l’éclatement de la famille, l’abandon, l’enfance perdue, la peur de l’inconnu, l’holocauste). Mais aussi, A.I. permet à Spielberg d’explorer des zones qu’il n’aurait pas eu le courage de sonder sans l’apport de son maître (notamment tout ce questionnement sur le thème de l’amour, des sentiments). Et, il s'agit du plus grand cadeau que Kubrick ait pu faire à Spielberg. C'est d'ailleurs à partir de ce film qu'il devient un cinéaste plus courageux, plus libre, et qu'il arrête de vouloir à tout prix plaire au public (les copies carbone de E.T. [1982]), ou bien plaire à l'Académie avec des films nobles et humanistes (le quelconque Amistad (1997) entre autres)
A.I. est un film difficile à apprivoiser à la première écoute, dû à sa grande richesse thématique. Mais comme un bon vin, il prend de la valeur avec le temps. Le thème central du film se tient dans cette question: "Si un robot peut aimer une personne, quel est la responsabilité de cette personne envers le robot? Doit-on aimer le robot en retour?" Au bout du compte, le film pose cette question universelle: qu'est-ce que l'amour? Cela provoque une infinité de question hyper pertinentes sur la nature humaine, et le film en est jalonné au fil du parcours de David (l'enfant robot abandonné par sa mère dans les bois et qui veut la reconquérir en devenant un vrai petit garçon, tel un Pinocchio moderne).
En traitant d'un univers saturé de robots-enfants, de robots-nounous, de robot-nounours, et de robots-prostitués (Gigolo Joe, joué par Jude Law), le film nous montre à quel point nos créations, nos robots, sont le fruit de nos manques (d'amour ou de réconfort), de nos désirs (sexuels, ou de gloire). Et c'est probablement ce qui nous fait le plus peur dans nos créations, ce miroir qu'elles nous renvoient (lorsque le véritable fils sort du coma, on se débarrasse du gamin factice qui n’entraîne que jalousie). Le film démontre clairement cette abjection généralisée face aux émotions jugées malsaines et difficiles. Les personnages humains cherchent des œillères pouvant occulter le mauvais, croyant trouver de cette façon le chemin du bonheur plus facilement. Les robots en sont un instrument (on en adopte un pour faire oublier l’enfant malade), jusqu’au moment où ils se mettent à évoquer le mauvais de nous-même. En d’autres mots, c’est cette non responsabilité vis-à-vis nos propres émotions qui nous tend vers le rejet de ces nouvelles technologies. Et ce qui fait de A.I. un film si intéressant, c'est qu'on peut appliquer cette idée de miroir aux créations du 7e art. Autant un robot peut attirer ou repousser la sympathie par ses émotions factices, autant un film peut rallier (ou rebuter) le public par les sentiments qu'il suscite. Et Spielberg a souvent été critiqué pour sa sentimentalité dans ses films, sa capacité à créer l'émotion (critiques souvent injustes, signe du rejet de ce que nous sommes au fond de nous). Mais A.I. est intéressant en ceci: pour la première fois, Spielberg remet en question son propre cinéma générateur d'émotions (et c'est probablement ce recul, cette distanciation qui n'a pas plu à un certain public avide du bon sentiment à tout prix, à l'abri de la réflexion). Spielberg utilise ses bons vieux tours d'antan, mais il nous dévoile du même coup leur supercherie. Sans en dire trop, la scène finale est un éventail de comment on peut créer un sentiment de réconfort chez quelqu'un qui souffre (robot ou pas). Certains y ont vu de la guimauve indigeste. Mais sous cette guimauve se cache ce constat à glacer le sang: on recherche tous une image, qu'elle soit réelle où irréelle. Et on peut se contenter d'une illusion pour être heureux. L'amour est le nom pour décrire cet indéfinissable concept, cette idée parasitaire qui mobilise notre vie entière. La quête, chez Spielberg, ne trouve plus d'aboutissement comme dans ses premiers films plus simplistes (la quête d'une montagne dans Close Encounters of the Third Kind (1977), la quête d'un requin dans Jaws [1975]). Cette fois-ci, pour le spectateur, la quête trouve son aboutissement avec amertume dans le constat lucide que la poursuite d'une image et du bonheur rattaché à sa conquête dépend d'un processus illusoire de perceptions, de comment l'on se perçoit soi-même dans ses objets, ses créations, ses désirs, ces images parasitaires. Et c'est dans cet esprit que Spielberg continuera sa carrière, plus adulte que jamais.
On peut dire que A.I. est un film charnière dans la carrière de Spielberg, celui qui le mena vers un cinéma plus intellectuel, mais aussi plus senti. Pour ma part, je le répète, il s'agit peut-être de son plus grand chef-d'oeuvre. Et la plus grande image pour décrire ce chef-d’œuvre est celle où David, prisonnier au fond de l’océan (dans un Manhattan submergé par la fonte des glaces), implore une statue de la fée bleue, lui demandant de faire de lui un vrai petit garçon. Dans cette scène, parmi les plus belles et poétiques qu’il m’ait été donné de voir, il implore cette fée bleue pendant 2000 ans jusqu'à se figer dans une seconde ère de glaciation. Pour moi, c’est l’image la plus représentative de notre état de spectateur de film. Elle renvoie à notre désir de s’accrocher inlassablement à des images qui n’ont aucune vie propre, mais qui nous apportent l’espoir ou l’émotion qui nous comblent. C’est à la fois d’une tristesse et d’une beauté infiniment glaçante.
2- THE NEW WORLD (2005) de Terrence Malick

Pour moi, Terrence Malick est le réalisateur qui a le mieux compris la 4e dimension au cinéma, celui qui éveille le plus intelligemment possible les cinq sens du spectateur. Chacun de ses films est d’une poésie sensorielle euphorisante. Avec lui, pas besoin d’Odorama, où de siège vibrant sous l’effet du tonnerre pour caresser les sens du spectateur. Il ne fait qu’utiliser savamment les bonnes vieilles méthodes du son et de l’image pour y arriver. Un montage expressif et poétique traversé d’ellipses et de collages, une photo naturaliste (sans éclairages artificiels), une bande son près des grondements de la nature, et de la musique classique qui amplifie les émotions d’une manière qui n’est pas sans rappeler celle de Stanley Kubrick sur 2001 : a Space Odyssey (1968). Avec ces bons vieux trucs d’antan, utilisés d’une manière unique, Malick réussit à évoquer des odeurs et des sensations tactiles dans ses images. Lors d’une scène, pour évoquer la naissance du sentiment amoureux, Malick nous présente un collage de plans très courts qui touchent directement nos sens : de l’eau coule dans le visage d’un personnage, un soleil qui éblouit, un éclair qui déchire le ciel, une nuée d’oiseaux qui se disperse. On arrive presque à sentir la brise orageuse nous parvenir. Et un frisson nous parcourt le corps.
The New World n’est pas un film historique à proprement parler. C’est une expérience sensorielle sur l’époque des grandes découvertes. Pas étonnant que Malick ait choisi de raconter l’histoire d’amour entre l’aborigène Pocahontas et l’explorateur John Smith. Quoi de mieux que le prisme de l’amour pour aborder le thème de la découverte d’une manière sensuelle, pour nous faire ressentir physiquement cette collision entre deux peuples. Une collision dans le sang et dans le cœur d’un peuple enfant vis-à-vis un peuple flirtant avec la grandeur des dieux.
Structuré subtilement en trois actes (marqués par la magnifique ouverture du Das Reingold de Richard Wagner), The New World nous fait traverser les 3 étapes d’une expérience humaine: la naissance (l’exaltation de la découverte, autant géographique qu’amoureuse), la vie (ce qu’on fait d’un nouveau monde), la mort (ce qu’on en garde). Comme pour The Thin Red Line (1998, le film jumeau de The New World), Terrence Malick nous propose une exploration spirituelle de notre nature. Il pose des questions, il observe, avec l’humilité de ne jamais se placer au-dessus de sa matière. Plutôt que de donner des réponses, le film se prosterne devant la complexité et la beauté de notre nature. En cela, The New World (son 4e film en 30 ans) est l’un des plus beaux films du monde.
3- MULHOLLAND DR. (2001) de David Lynch

La réponse du réalisateur David Lynch à ceux qui lui demandaient « Quel est la signification de ton film?» ressemble à peu près à ceci : « Mon cinéma ressemble aux rêves. Comme pour les rêves, on ne doit pas essayer à tout prix de le comprendre sur le moment. Il suffit de s’y laisser aller, en laissant la rationalité de côté, pour mieux profiter de l’expérience. Il suffit de regarder ce qui se passe en nous, d’en observer les effets ». C’est une réponse qui peut sembler facile, surtout qu’elle peut excuser à l’auteur ses pires excès (on s’entend pour dire que David Lynch est un artiste à l’ego suffisamment fort pour se permettre de faire à peu près n’importe quoi. D’ailleurs, il a déjà frôlé le n’importe quoi dans le passé, avec des films comme Twin Peaks : Fire Walk with Me (1992) et Lost Highway (1997), puis dans une moindre mesure Inland Empire (2006). Ces films, je les ai tous adoré, mais force est d’admettre qu’il peut être difficile pour les non-initiés de s’accrocher à quoi que ce soit dans cet onirisme sans repères où la cohérence est difficile à cerner).
Ceci étant dit, Mulholland Drive est un cas à part. C’est peut-être le film le mieux balancé de David Lynch sur les rêves depuis Blue Velvet (1986). Dans ce film, tout s’emboîte comme par magie. D’une part, l’idée que le film se déroule à Hollywood (le pays des rêves par excellence) apporte beaucoup de cohérence aux bizarreries oniriques de Lynch. Car bizarreries, il y a. À un moment du film, les personnages changent inexplicablement d’identité. Ils en viennent même à se vampiriser (par exemple, dans cette scène magnifiquement lesbienne). Vous l’aurez deviné, le film traite du problème identitaire ressenti par les actrices (et aspirantes actrices). Et c’est Naomi Watts, qui se donne d’ailleurs complètement à son rôle, qui joue la blonde et aspirante actrice fraîchement arrivée dans la jungle hollywoodienne. Elle héberge chez elle une mystérieuse brunette amnésique qui se révèle être une actrice en pleine ascension. La blonde veut devenir la brune, et inversement. Une relation un peu malsaine se développe entre les deux, évoquant celle du film Persona (1966) de Bergman (où l’une se servait du mutisme de l’autre pour mieux se projeter en elle). Au final, la blonde se retrouve dépossédé d’elle-même à son tour, finit par régresser, et se retrouve fantasmatiquement dans la peau d’une serveuse de restaurant assassinée. What the fuck? Les actrices seraient-elles des objets remplaçables ou interchangeables, manipulés par les forces obscures qui se cachent derrière les murs sombres d’Hollywood. On ne comprend pas trop. Mais on a vraiment l’impression de passer un sale moment dans la tête de ces femmes en crise identitaire que Hollywood démoli. Le joli rêve de la première partie et le cauchemar de la deuxième donne un contraste terrifiant et carrément schizophrénique.
Pour ma part, de tous les films de papy Lynch sur les rêves, Mulholland Drive est le seul qui réussit à faire naître une réelle émotion sans agresser le spectateur d’images malsaines. Il génère une grande beauté poétique en faisant défiler sous nos yeux une mascarade de désincarnés personnages tous hantés par cette promesse d’un monde paradisiaque véhiculé par Hollywood. Lynch savait très bien en réalisant son film que cette image puissante et glamour d’un paradis si convoité faisait partie de notre inconscient à tous, spectateurs de films. Le bonheur est qu’il a choisi de s’amuser comme un petit fou avec ce sentiment enfoui en nous. En jonglant avec des émotions universelles qui sont très proches de nous, Mulholland Drive est le Lynch qui établit le mieux un contact avec l’inconscient de son public (en tout cas le mien). Et c’est en nous incluant dans son film, en tant qu’acteur témoin et fantomatique (ces nombreux plans qui flottent dans le décor ne sont peut-être pas si anodins), que Lynch atteint les sommets de son art, et flirte avec une poésie qu’on ne lui soupçonnait pas. Je n’oublierai jamais le visage innocent de Naomi Watts lorsqu'elle fait son entrée à Los Angeles. Un sourire naïf digne des « soap opera », le regard vers le ciel, et la fantastique musique de Badalamenti qui vient amplifier cette innocence. Ce plan est fort, car on sait qu’elle va en chier. On sent que le voyage qu’elle fera au pays des merveilles ne sera pas de tout repos. Et on sait Lynch assez doué pour la déconstruction. Mulholland Drive est un trip cinématographique absolument puissant et unique. Du grand cinéma hallucinant qu’il faut découvrir avec ou sans pétard.
4- GERRY (2002) de Gus Van Sant

Il s’agit du premier film qui a redéfini le style de Gus Van Sant. La première fois que ce dernier décide de s’inspirer ouvertement d’un cinéma plus contemplatif (comme celui du hongrois Bela Tarr, qu’il a toujours admiré). Et c’est un événement franchement enthousiasmant et courageux venant de la part d’un cinéaste devenu « mainstream » avec des films comme Finding Forrester (2000) et Good Will Hunting (1997). La preuve d’un cinéaste qui ose et refuse de s’asseoir sur ses lauriers.
Gerry est un film sur deux amis (Casey Affleck et Matt Damon) perdus dans un désert des États-unis. Assez simple. Mais cela permet à Van Sant d’expérimenter. Gerry est une œuvre poétique, et purement cinématographique sur l’espace et la temporalité. L’intérêt du film est que Van Sant explore son médium en se refusant à tout effet de montage (ces effets qui ont trouvé aboutissement dans le vidéoclip), particulièrement ceux qui hachent abusivement l’espace et le temps pour créer un rythme, une émotion, une idée romantique. Gerry est une suite de plans séquences que Van Sant laisse exister pour ce qu’ils sont. Des moments dans le temps que l’on ne pourrait pas ressentir d’une manière aussi profonde si on zappait pour multiplier les points de vue, ou pour en changer le sens par des effets Koulechov (plan neutre trouvant un sens grâce au plan qui le précède).
Une scène nous présente les deux personnages marcher dans le désert. Normalement, cette seule représentation nécessite quelques secondes au spectateur pour bien assimiler l’info. Qu’à cela ne tienne, Van Sant laisse durer le plan pendant 10 minutes, jusqu’à ce que le soleil se lève complètement. En sortant de la salle, on se rend compte de tous ces moments précieux que l’on ne veut pas laisser durer dans leur intégralité (ces moments de plus en plus facile à négliger avec l’avènement du fast-food affectif nommé Internet). On se rend compte également du danger de ces espaces qui semblent infinis, de leur beauté perverse. Et Van Sant a eu la très bonne idée d’utiliser la musique de Arvo Pärt sur certaines scènes. Sa musique minimaliste aux motifs répétés qui s’étendent à l’infini rajoute beaucoup à cette œuvre sur la temporalité, sur l’infinité. Un film d’une pureté absolue. Celui que j’ai toujours rêvé faire.
5- ELEPHANT (2003) de Gus Van Sant

Qui n’a pas déjà fantasmé, même vaguement, sur cette idée d’entrer dans un lycée armée jusqu’à la moelle et tirant à bout portant sur tous les gênants personnages qui le compose? Il serait hypocrite de le nier. Ce genre d'image nous a tous traversé l’esprit à un moment ou à un autre dans cette période d’adolescence, dans des moments d’injustice, ou de persécution. Souvent, dans un sentiment d’infériorité par rapport aux standards encouragés. L’image du massacre est une image parfaitement normale chez l’adolescent. Et d’ailleurs, il ne s’agit que d’une image. Il y a tout un monde entre le fantasme et l’acte. Et le moteur de ce passage à l’acte est une chose assez difficile à expliquer. Ceux qui tentent de l’expliquer échouent lamentablement, et ne font que s’attirer un capital de mépris de la part des ados. On ne prévient pas un geste de la sorte avec des œuvres moralistes dignes des vidéos scolaires. Pas plus qu’on encourage la jeunesse américaine avec des films d’ados sur la « success story » d’un étudiant qui finit par emballer la fille en supplantant tous ses adversaires. Au cinéma américain, le lycée est une utopie complètement déphasée. Et il était temps qu’un réalisateur de la trempe de Gus Van Sant finisse par nous présenter à sa manière ce qui s’y passe réellement, dans toute sa noirceur et sa beauté.
En cela, j’aime la grande simplicité et l’absence de prétention de Elephant, inspiré par la tuerie de Colombine qui avait eu lieu dans un lycée américain en avril 1999. Van Sant continue d’observer à la manière de son précédent film Gerry (2002), c'est-à-dire en tout humilité, sans raisonnement de cause à effet, sans chercher d’explications. Il contemple. Il constate. Il se contente de laisser la caméra tourner sans l’interrompre (en la déplaçant toutefois d’une manière très contrôlé et fluide). Mais ce n’est pas un trip formel, car au final on ne sent pas du tout la caméra (comme si un spectre voyeur traversait l’environnement).
Étant donné qu’il ne coupe pas ses plans et qu’il garde intact la temporalité (sans jamais la « puncher » ou la rythmer abusivement à l’aide du montage), on a l’impression d’observer quelque chose de très réel, dépourvu d’un point de vue écrasant et accusateur. Autrement que pour Gerry (où Van Sant explorait la temporalité dans une approche plus contemplative et poétique), Elephant adopte un point de vue plus social en présentant toutes les facettes du milieu scolaire américain à travers ses multiples figures. Un peu à la manière du Rashomon (1950) de Kurosawa, il multiplie les points de vue en répétant plusieurs fois une même portion de temps (celle qui précèdent la tuerie) tout en changeant de personnages à chaque fois. La grande différence est que Elephant n’est pas un film sur la perception, ni sur la multiplication des subjectivités et ses différents niveaux de réalité. Le procédé de multiplication de point de vue est utilisé ici dans le simple but de fragmenter l’événement en autant de figures possibles (celles qui composent l’école américaine). Van Sant propose ici une étude en profondeur de chacune de ces figures. Et l’intelligence de Van Sant est de ne jamais juxtaposer ces plans séquences à d’autres plans susceptibles d’apporter des réponses sur l’origine de cette tuerie. Il y a bien certains plans qui présentent les futurs tueurs jouant à des jeux vidéos violents, regardant des vidéos nazis. Mais d’autres les montrent jouant du piano et écoutant du Beethoven. Au final, ce ne sont que des détails, et ça n’explique pas leur comportement. Ce ne sont que des éléments accessibles à tout le monde. Et Van Sant, en nous faisant confiance, a choisi clairement de montrer ces indices pour nourrir nos questionnements. Il ne juge pas, seul le spectateur est susceptible de le faire. C’est pourquoi j’ai eu l’impression d’avoir affaire à un film vrai et crédible sur le milieu scolaire. Cette absence de « bullshit », d’accusations faciles, et de démagogie propre aux films américains fait du grand bien. On est très loin du cinéma de Michael Moore. Par son absence de prêcheries suffisantes, Elephant est un film important de la décennie 2000. C’est un cadeau du ciel à tout ceux et celles qui se sont intoxiqué de films avec Freddie Prinze Jr.
6- IN THE MOOD FOR LOVE (2000) de Wong Kar-Wai

In the Mood for Love est un film hongkongais extrêmement beau. Esthétiquement très beau. Mais la beauté qu’on y retrouve n’est pas exposée dans un simple but d’exhibition. Il y a une grande profondeur dans cet esthétisme. Pour Wong Kar-Waï, l’esthétisme devient le langage des cœurs, celui des amours inavouées. Un homme et une femme louent chacun une chambre côte à côte. Tout deux trompés dans leur union respective, ils trouvent réconfort l’un vers l’autre en entreprenant une relation clandestine et chaste (à l’écran du moins). Pour chaque désir inavoué, pour chaque geste retenu, on retrouve un équivalent visuel. Que ce soit une main hésitante qui tourne une cuillère nerveusement et sensuellement dans une tasse de café lors d’un tête à tête au restaurant, ou ces ralentis langoureux lors de ces rencontres nocturnes inattendues au milieu d’une ruelle à la pluie battante. Ce film démontre à la perfection cette espèce d’énergie amoureuse qui émane des corps, au-delà des gestes d’amour. Au-delà de ces gestes maintes fois représentés, articulés, et banalisés dans le cinéma américain. En ce sens, In the Mood For Love est un film hors du commun, par sa manière d’exprimer l’amour à l’aide d’images et d’ambiances. Pour moi, il s’agit d’un chef-d’œuvre purement cinématographique sur le désir amoureux. Une œuvre importante et intemporelle qui traversera les époques.
7- Star Wars: Episode II – THE ATTACK OF THE CLONES (2002) de George Lucas

L’Attaque des Clones est un titre plutôt évocateur pour décrire le deuxième préquel de la saga mythique de Star Wars. Il s’agit d’une expérience de clonage visuel tout à fait fascinante. Et dans notre ère d’imagerie numérique, cloner le passé en le mêlant au présent peut donner quelque chose de merveilleusement racé. Un peu à l’image de Darth Vador, mi-homme, mi-machine, The Attack of the Clones est une bête étrange que le créateur de Frankenstein n’aurait pas reniée. Lucas s’est pété un trip de fou en greffant au cadavre de sa vieille trilogie de jeunes membres tout frais, déclanchant ainsi la colère des fans de la première heure. Dommage, car pour apprécier la saga dans son ensemble, je dirais qu’il faut d’abord comprendre ce style de cinéma propre à Star Wars. Car il s’agit d’une forme de cinéma assez particulière qui semble s’abreuver d’absolument tout, sans discriminations, avec une soif impressionnante et intarissable. C’est un cinéma unique que peu de réalisateurs ont réussi à maîtriser avec autant de sincérité que George Lucas. La plupart des réalisateurs post-moderne, en pastichant, en rendant hommage aux récits qui les ont inspirés (par exemple le film Shrek (Andrew Adamson et Vicky Jensen, 2001) qui revisite le conte de fée), s’excusent du même geste en insérant des répliques cyniques du style «nah, ce n’est plus sérieux aujourd’hui! ». Lucas est l’un des seuls qui, en se modernisant, n’a pas perdu son respect du matériel d’origine, des récits fondateurs. Et en les mélangeant aux artefacts modernes, il réussit à retrouver la puissance d’évocation de ces récits d’origine dans lesquelles il puise. L'Episode II est sa plus grande réussite en ce sens. Le mélange y est hyper savant, à des années lumières du charabia artistique de l'Episode I. Car ce n'est pas tout de mélanger, il faut savoir équilibrer pour rendre une oeuvre harmonieuse et émouvante, pour éviter l'anarchie visuelle.
The Attack of the Clones, en particulier, s’apparente à un magnifique collage pop art. La vignette (un peu plus haut), nous en donne un très bon exemple. On y trouve le mélange des trois couleurs évocatrices de la vieille trilogie. Le blanc qui évoque la princesse Leia, le noir qui évoque le costume de Darth Vador, et le beige sur Obi-Wan renvoie à Tatooine, la planète où ce dernier trouvera exil. Avec cette économie de couleurs, The Attack of the Clones opère un retour au minimalisme des anciens épisodes IV, V, et VI. Cette vignette nous rappelle tout de suite les vieux Star Wars en s’adressant directement à notre subconscient. Un seul élément jure avec le reste, la trop grande netteté de l’image. Dans nos souvenirs, Star Wars évoque des images imprimés sur de la pellicule granuleuse, des silhouettes se tenant dans un désert ocre et poussiéreux. Ici, on se retrouve avec une image hyper net (filmé avec une caméra HD numérique) de trois personnages aux couleurs « star warsienne », se tenant dans un environnement au sable propre et orangé. Les couleurs de base restent les mêmes, mais les temps ont changés, les environnements changent aussi. On peut dorénavant s’amuser à coller nos acteurs sur une infinité de « background ». Le look poussiéreux d’antan style Benhur rencontre Capitaine Cosmos peut maintenant prendre une forme plus évolué, lorgner vers le orangé de planètes plus exotiques. Et cette absence de limites, cette perfection visuelle, fait tout de suite penser à l’univers visuel des jeux vidéo. Lucas s’en amuse d’ailleurs, et va jusqu’à monter des scènes complètes qui renvoient à certains jeu de combat sur platforme (juste retour des choses, car l’industrie du jeu vidéo doit beaucoup à la trilogie originale). Dans sa gourmandise formelle, le film finit même par donner un look presque plastique (celui des figurines que Lucas a popularisé, justement). À regarder les cheveux de Obi-Wan, on jurerait qu’ils ont un aspect chromé, lissé, digne de ces bonhommes en plastique à l’effigie des héros romantiques de l’espace. Un jouet playmobile à la limite! Et cet aspect lisse et propre, généralisé dans tout le film, témoigne de cette hybridation fascinante entre mythologie poussiéreuse et modernité.
The Attack of the Clones, malgré ses innombrables maladresses, est un film touchant. Pour moi, il s’agit de l’épisode le plus réussi, le plus aboutie de la saga Star Wars. L’amour de Lucas pour toutes les formes de récits existants transparaît plus que jamais dans cet épisode. Il s’est un jour donné le pari de raconter une saga universelle pouvant toucher tous les peuples, toutes les religions. Pour ma part, le pari a été accompli haut la main sur The Attack of the Clones (d’une richesse incroyable). Et la grande réussite de Lucas sur cet épisode est d’avoir su le rendre homogène, malgré le foisonnement extrême d’éléments et de références hétéroclites qu’il renferme. Il s’agit peut-être de l’épisode le plus intense à ce niveau. On passe du roman Harlequin au péplum, en passant par le soap opéra, les « serials » de science-fiction du samedi matin, le film de guerre, le polar, le film politique, les films de propagande allemands de Leni Riefenstahl, la mythologie américaine (James Dean, les années 60, les westerns de John Ford), la spiritualité orientale, la Grèce antique, la psychanalyse freudienne, le film d’art martial. Ouf! Et j’en passe. Le tout forme un ensemble un peu plus naïf que l’excellent et mature Revenge of the Sith (2005), mais beaucoup mieux balancé. Car l’amour de Lucas pour l’univers qu’il a créé transparaît autant dans les scènes intimistes que dans les morceaux d’actions (beaucoup plus mémorables, inspirés et funs que dans l’Épisode III par exemple). Le film réussit également, sur le plan dramatique, a nous faire oublier l’impertinence de l’Episode I. Pourtant, les fans n’ont pas été convaincus.
En sachant que l’époque candide des années 80 était révolue, Lucas a eu l’audace de se lancer dans cette entreprise nostalgique en ne changeant rien du ton naïf de la vieille trilogie, en conservant les mêmes références (plus difficiles à accepter aujourd’hui). Résultat : il s’est attiré la colère des fans de la première heure (qui ont bien évidemment vieilli). Un constat pas si étonnant, étant donné que la machine à rêves hollywoodienne était à son apogée dans les années 80 et nous vendait des films comme on vendait des jouets. Ces films/jouets, on voulait qu’ils nous appartiennent. Cette trilogie Star Wars originale, c’est un peu le joujou d’enfance qu’on se plaisait bien à retrouver de temps à autre. En revanche, la nouvelle trilogie est un peu ce jouet remodelé que l’on ne veut pas reconnaître. Pourtant, en faisait l’effort de reconnaître la cohérence de ce nouveau jouet, on se rend compte que The Attack of the Clones n’est pas si différent de Empire Strikes Back (Irvin Kershner, 1980), l’épisode le plus apprécié. On y retrouve le même romantisme, la même naïveté, la même structure épisodique, le même sens du théâtre, et le même style de mise en scène un peu statique (avec cette manière de terminer les scènes avec cadrage « plan d’ensemble » et personnages se figeant en attente du fondu enchaîné, comme dans les films muets). Encore mieux, l’Episode II évite les défauts de ses prédécesseurs. Le scénario est structuré d’une manière plus satisfaisante, car il réussit à évacuer toutes ces scènes et éléments inutiles qui entravaient le développement des épisodes originaux (Han Solo prisonnier de la carbonite et son interminable sauvetage dans l’épisode suivant, même si fun, n’apportait absolument rien a la progression dramatique). Lucas s’est efforcé d’épurer son scénario, et s’est essayé à plus de profondeur. Les épisodes II et III ne sont pas aussi relâchés et désinvoltes que leurs prédécesseurs, mais leurs scénarios sont vraiment à propos de quelque chose. Il était d’ailleurs plutôt improbable que Lucas fasse de sa nouvelle trilogie une envolée lumineuse avec les personnages légers et sympathiques que la horde lui réclamait. Après tout, cette nouvelle trilogie ne portait-elle pas sur la chute d’Anakin vers le côté obscur de la force?
Toutefois, malgré sa rigueur cohésive le film comporte certaines maladresses qui l’handicape et l’empêche de toucher une majorité de spectateurs. En prenant l’énorme risque d’explorer une aussi grande palette de récits, en voulant toucher à l’universalité, Lucas rate sa tentative de créer une œuvre qui puisse plaire à tout le monde, et surtout aux fans. Fait assez paradoxal, car on ne peut pas dire qu’il a oublié de s’adresser à quiconque. Il s’est d’ailleurs aventuré très loin en puisant dans les formes de récit que la vieille trilogie n’avait jusqu’alors qu’effleuré. N’empêche qu’en utilisant autant d’éléments hétéroclites, il s’agit que le spectateur ne soit pas à fond dans un seul de ces éléments, et le film s’écroule comme un château de carte. C’est là la grande fragilité de The Attack of the Clones, mais aussi sa grande beauté. Comme mentionné plus haut, Lucas ne fait pas de discrimination. Par exemple, il n’hésite pas à emprunter aux romans Harlequins et aux soap opéra quand vient le moment de traiter des tourments amoureux de Anakin et Padmé. Il n’hésite pas à emprunter l’art du dialogue naïf et télévisuel pour laisser ses personnages s’exprimer. Il en résulte des scènes plutôt difficiles à avaler si on s’attend à du réalisme. Mais Star Wars n’a jamais été réaliste. Star Wars synthétise grossièrement en des phrases très épurés et simples, en des scènes essentiellement visuelles et lyriques, les enjeux et les drames. Nous sommes dans l’univers des séries à la Flash Gordon, et l’illustratif prime avant tout. La concision narrative également. De toute façon, Lucas ne croit pas à cette histoire d’amour entre adolescents. Les spectateurs auraient aimé y voir une belle alchimie entre les acteurs, mais Lucas sait très bien où cette relation s’en va. Il ne perd pas son temps à la rendre crédible. Il la présente comme superficielle, maladive, obsessionnelle, anémique, nourrie par la dépendance et la désespérance. Il n’y a ni beauté ni vie dans cette relation vouée à l’échec. Elle n’est que systématique, mue par un mécanisme oedipien, avide d'un romantisme ornemental. D’ailleurs, la seule beauté se trouve dans la forme que Lucas a utilisé pour nous présenter cet amour illusoire. Et cet enrobage tout en grandiloquence participe à synthétiser les clichés de l’adolescence en une sorte de peinture stylisée, comme pour mieux témoigner de ses dérives, en dévoiler le côté un peu toc. Et Lucas n’y va pas de main morte. Il met carrément les clichés à l’avant-plan, se servant des archétypes comme instruments quasi esthétiques, comme si c’était les couleurs d’une palette de peinture. Les coups de pinceau peuvent être grossiers, c’est le résultat global qui intéresse Lucas. De l’ensemble de ses couleurs, son idée est d’aller chercher une ambiance, une émotion, une illustration, et non créer une peinture réaliste. Et cela fonctionne, pourvu qu’on accepte cet aspect collage du film. Et en se laissant prendre, il est facile de voir Star Wars comme une œuvre d’art, il est plus facile de sentir la sincérité créatrice de l’auteur et de laisser de côté ce mépris que l’on peut ressentir vis-à-vis certaines formes de récit. Visiblement, Lucas aime profondément, sans la moindre pointe de cynisme, toutes ces formes de contes, de langages, et de codes auquel il rend hommage. Et sans discrimination, il les fait cœxister. C’est cela qui déstabilise. The Attack of the Clones nous ramène à ce cinéma d’antan où la somme des éléments, l’émotion d’ensemble, comptaient plus que l’infime détail (que l’on ne manque jamais de critiquer de nos jours).
Stanley Kubrick disait du cinéma que c’était une photo d’une photo de la réalité. Pour George Lucas, il s’agirait plutôt d’une photo d’une photo d’une photo de la réalité, car il a toujours été attiré d’avantage par la force visuelle du médium cinématographique que par le réalisme et la chimie des interactions humaines. C’est un réalisateur plutôt maladroit, trop intellectuel, pas assez chaleureux. Et ce n’est certainement pas un grand directeur d’acteur, ni un dialoguiste très inspiré. Mais il n’a jamais eu la prétention d’aller au-delà de ses limites. Bref, il n’a jamais essayé de faire du Shakespeare. Et par chance, la naïveté des années 70 et 80 ont beaucoup aidé à bien faire passer les faiblesses de ses premières oeuvres. Mais surtout, le genre de films qu’il réalisait rendait illico leurs faiblesses plus légitimes (le film d’ado dans American Graffiti (1973), le « space opera » dans Star Wars (1977), et la sci-fi expérimentale dans THX 1138 (1971). Que de genres et moyens de se permettre un peu de désinvolture ou de maladresse). On retrouve d’ailleurs le même phénomène chez un réalisateur comme John Carpenter qui, sans être un grand directeur d’acteur, évolue avec succès dans l’univers plus indulgent des films d’horreur fauchés.
Le principal problème de la nouvelle trilogie de Star Wars, c’est qu’elle s’aventure justement dans des sphères moins propices à l’indulgence, celles de la tragédie. Aujourd’hui, alors que le spectateur est nourri abondamment d’ultra-réalisme, la tragédie lyrique un peu lourde ne passe plus, surtout enrobé du style naïf d’autrefois. Et à cause des limites imposées par ce style très opératique, les acteurs ont dû se débrouiller tant bien que mal avec une approche très intellectuelle et conceptuelle de la direction d’acteur. Selon moi, ils ont fait des miracles malgré quelques fausses notes. Mais l’élément le plus casse-gueule de cette nouvelle trilogie, c’est le personnage antipathique d’Anakin. Il faut donner mérite à Lucas d’avoir eu l’honnêteté et le courage d’en avoir fait un personnage détestable. En traitant précisément de la genèse du légendaire Darth Vader, avant qu’il ne devienne ce méchant et grotesque colosse, Lucas savait qu’il n’allait pas pouvoir rassembler autant de fidèles. Il savait aussi que le personnage d’Anakin allait être détesté pour son côté arrogant, antipathique, immature, mal à l’aise, pourtant il n’a pas essayé d’en faire un personnage attachant. Il le présente comme un anti-James Dean qui a tout du look rebelle, mais qui manque incroyablement d’assurance. Ce qui est un exploit pour un film « mainstream » sensé nous rassurer avec un personnage principal attachant. Et c’est probablement pourquoi le public a détesté le jeu de son interprète, Hayden Christenssen. Son personnage est dépourvu de charisme, car il s’agit d’un ado mal dans sa peau, la reproduction parfaite du californien moyen qui veut grandir trop vite et emballer la fille. Il est fort possible que le personnage ait été détesté bien plus que la performance. Quant à moi, le jeu de Christenssen est parfait, si on accepte le ton de Star Wars et cet aspect théâtral, un peu affecté, que l’on retrouvait dans les vieilles séries de sci-fi. Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, jouaient tous de la même manière dans les originaux… mais la camaraderie et l’humour du scénario était plus rassembleur. Bien sûr, la nouvelle trilogie raconte une autre histoire, plus tragique.
The Attack of the Clones est une drôle de créature, un peu maladroite et empoté. Mais, il n’en demeure pas moins que le monstre est bien vivant. Lucas aurait pu rester dans sa zone de confort, à nous resservir la même soupe d’il y a 30 ans, avec ces mêmes courses poursuites entre chevalier et soldats impériaux. Mais il nous aurait servi un cadavre. Au lieu de ça il a décidé d’explorer. Il s’est lancé en chirurgie. Et même si on perd le côté organique d’antan au profit du numérique, même si la camaraderie entre Han Solo et Luke Skywalker manque à l’appel, The Attack of the Clones est une œuvre parfaitement vivante, preuve du désir de Lucas d’expérimenter, de se renouveler sans cesse. Un beau film artisanal, ludique et intemporel, qui témoigne d’un processus créatif admirable et franchement émouvant. Mais la réussite n’en serait rien si Lucas ne se racontait pas à travers son univers. Et c’est ce qui élève ce film au-dessus de la moyenne des blockbusters habituels, et surtout au-dessus de l’Episode I – The Phantom Menace (1999, dramatiquement très faible). Avec American Graffiti, The Attack of the Clones constitue l’œuvre la plus personnelle de George Lucas. À travers le personnage d’Anakin, Lucas exulte son adolescence à Modesto en Californie, et ce jeune garçon arrogant qu’il a été jadis. Ce p’tit gars qui voulait grandir trop vite, cueillant les filles dans la rue investi d’une voiture sport, disputant des courses dans les rues de la ville et frôlant la mort de près dans un spectaculaire accident de voiture qui lui valu un séjour dans le coma et des mois dans un lit d’hôpital connecté de partout. Et c’est cela Star Wars, l’histoire d’un ado qui finira par se brûler, terrorisé par la solitude et aveuglé par la réussite instantané. Celle d’un ado apeuré et impatient dont le destin sera scellée à l’intérieur d’une armure médicale noire et un masque respiratoire, ceux du méchant Darth Vador. Tout l’essence de Star Wars se retrouve là. En ce sens, The Attack of the Clones et sa suite Revenge of the Sith, aidés de leurs maladresses charmantes, sont les segments les plus purs et viscéraux de toute la saga, envers et contre tous leurs détracteurs. Et l’Episode II en constitue l’œuvre maîtresse, ma préférée à moi tout seul.
(si l’univers de Lucas vous intéresse, vous pouvez lire une splendide analyse de la saga Star Wars par Corinne Vuillaume, particulièrement concentré sur l’Episode III – The Revenge of the Sith. Cliquez ici).
8- UN CONTE DE NOËL (2008) de Arnaud Desplechin

Un conte de Noël n’a rien à voir avec l’histoire poussiéreuse d’Ebenezer Scrooge. Il s’agit plutôt d’un drame familial extrêmement sombre où les personnages d’une famille profite d’une réunion du temps des fêtes pour régler leur compte. Il s’agit d’une œuvre typique de son auteur Arnaud Desplechin. Un auteur-réalisateur que j’ai découvert très récemment et que j’admire énormément. C’est un cinéaste qui sait allier le bavard aux mouvements. Ses films sont très dialogués et intellectuels, mais ne tombent jamais dans les pièges d’un cinéma trop statique, trop théâtral. Ses films proposent souvent des échanges très musclés et conflictuels entre des personnages passablement névrosés, mais le tout est fait d’une façon hyper cinématographique, car le réalisateur use d’une grande créativité au niveau de sa mise en scène. C’est d’ailleurs pourquoi Un Conte de Noël a beaucoup été comparé au Fanny et Alexandre (1982) de Bergman (une autre grande fresque familiale se déroulant pendant la fête de Noël). Mais force est d’admettre que Desplechin est un plus grand virtuose, de par sa manière plus moderne, de par sa caméra plus mouvante, de par son montage plus rapide. Parfois, Un Conte de Noël étourdit tellement il foisonne d’idée de mise en scène. Il étourdit, mais n’ennuie jamais. Il faut dire que les dialogues sont extrêmement bien écrits. D’une honnête cruauté surtout. Ceux entre le fils mal aimé et sa mère sont quasi incroyables de méchanceté. Mais c’est aussi comme ça que ça se passe dans une famille. On l’oublie trop souvent. C’est un champ de bataille perpétuel entre egos. Et la force du cinéaste est de nous présenter cet environnement familial, que d’aucuns trouveraient malsain, comme quelque chose de parfaitement normal et presque sain. Il ne porte aucun jugement, ne propose aucun idéal de la famille d’ailleurs, que la vérité exposé dans toute sa crudité. Un film hyper juste et intelligent, mais aussi très stimulant cinématographiquement. Une réussite sur tous les plans.
9- SARABAND (2003) de Ingmar Bergman

Saraband est l’œuvre testamentaire d’un des plus grands cinéastes que je connaisse, Ingmar Bergman. Le dernier chef-d’œuvre qu’il livra, à l’âge de 85 ans, avant son décès en juillet 2007. Et la proposition qu’il nous fait est plutôt intéressante. Retrouver les personnages d’un de ses grands films des années 70, Scènes de la Vie Conjugale (1974).
Les retrouvailles sont ardus (les personnages, 30 ans après leur divorce, n’auront pas trouvé la sérénité recherché), mais aussi émouvantes, car les rides des acteurs vieillissants (Liv Ullman et Erland Josephson, que l’on a connu si jeunes dans le premier film) contribuent à la force dramatique et désespérée du film. Cela renforcit cette espèce de nostalgie pernicieuse entre les anciens amants. Le film n’en reste cependant pas là. Le cœur du film se concentre plutôt sur leurs enfants, et leurs relations conflictuelles (ou carrément absente) avec eux. Le film semble mesurer la distance entre les personnages. Cette distance que certains personnages tiennent à conserver, et que d’autres ne pourraient tolérer. Bergman nous propose une observation fascinante sur le deuil émotionnel. Il ne révolutionne en aucun cas son cinéma, mais on ne peut cracher sur l’extrême lucidité, la sensibilité, et l’intelligence d’un scénario éminemment sincère qu’il nous livre pour une dernière fois avec cette manière généreuse et sans concession qu’on lui connaît. La seule chose qui a changé? La netteté de la caméra numérique qu’il a employée. On cherche en vain les grains et la saleté dans l’image, se rappelant celle plus onirique et texturé de Sven Nykvist dans les Bergman-couleur des années 70-80. Mais cela ne nuit pas à la force dramatique du film. Au final, par cette attention particulière que Bergman donne à ses acteurs et aux dialogues, par cette exigence maniaque de la perfection la plus élevée, le contenu du film est d’une force implacable qui supplante presque l’esthétique. On ne porte attention qu’aux personnages, merveilleusement campés, et à leurs dialogues. Chacun d’eux est d’ailleurs parfaitement détestable, mais aussi parfaitement attachant. En multipliant les écoutes du film, on prend partie pour un personnage à la première vision, et tout dépendant de notre humeur, on rejoint le clan ennemi à la seconde vision. Déstabilisant. Pour chaque parole cruelle, pour chaque geste immonde, on trouve des raisons parfaitement justifiables pour excuser chacun des personnages. Encore une fois chez Bergman, l’absence de jugement nous met dans tous nos états. On voudrait se faire prendre par la main, se faire rassurer, se faire montrer la bonne voie, la bonne attitude. Mais Bergman nous fait confiance. Et pour cette raison, il a tout mon respect.
10- SWEENEY TODD: The Demon Barber of Fleet Street (2007) de Tim Burton

Il s’agit de l’adaptation d’une comédie musicale de Broadway très macabre écrite par Stephen Sondheim (West Side Story), où un barbier revient à Londres après des années d’exil dans le but de se venger du juge qui l’a incarcéré pour lui ravir sa fille et sa femme. Il se réinstalle en ville comme barbier en se cachant sous l’identité de Sweeney Todd. Son désir de vengeance est telle que tous ces nouveaux clients écoperont de sa rage dans un bain de sang (le tout bien couvert par la restauratrice d’en bas, qui décide d’utiliser la chair des cadavres pour ses tourtes).
La bonne idée du réalisateur Tim Burton est d’avoir utilisé les pièces originales de la comédie musicale afin de les faire interpréter par des acteurs qui, à défaut de savoir chanter à la perfection, possède une palette d’émotion plus variée que les chanteurs d’opérettes sur Broadway. Et l’interprétation de Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, et de Sacha Baron Cohen (Borat lui-même) est tellement forte qu’elle arrive à nous faire oublier les imperfections de leur voix. Ce choix suffit à dépoussiérer l’œuvre de Sondheim et son côté un peu constipé par la dimension opératique (souvent trop grandiloquente de voix portées). Dans la version film, Burton insuffle une saveur, une folie, un humour iconoclaste qui désamorce le trop plein de solennité qu’un tel « musical » pourrait avoir. Et cela sied très bien à l’œuvre de Sondheim.
Ça fait également du bien de se passer de Danny Eflman le temps d'un film. Un bain de fraîcheur. C'est une question de goût, mais je trouve que la musique de Sondheim est beaucoup plus souple que celle d'Elfman (qui se tient souvent dans les mêmes teintes sonores monotones, et colle d'une manière très (trop?) illustrative aux images). Je trouve la musique de Sondheim plus culotté, dans le sens où il risque la naïveté, le lyrisme, les sommets opulants, le grandiose, tout ça dans un récit sombre et claustrophobique. Sa musique est plus décalé, ne se contente pas d'illustrer un ton, elle apporte un supplément, une puissance. Cela donne un souffle et une énergie au film de Burton. Par exemple, j'aime bien la naïveté inappropriée de la chanson de Johanna, et celles chanté par le jeune matelot naïf (qui rêve de sauver la fille de Sweeney). J'aime cette fragile candeur qui s'oppose à cette noirceur. Ça confère au film une ironie cruelle, un certain ludisme. Et ça aide le film à ne pas trop nous saturer de noirceur déprimante.
La qualité de la pièce et de la musique de Sondheim y est pour beaucoup dans mon appréciation du film (que je ne me lasse jamais d’écouter). Mais la violence créatrice de Tim Burton pour ce film m’a estomaqué avant tout. Jamais je ne lui avais soupçonné une telle force explosive… même à l’époque de Edward Scisorhands (1990). Et cette force se retrouve dans tous les éléments de ce film (qui se présente comme un sommet burtonien sur le plan graphique); la photo lugubre de Dariusz Wolski, la couleur surréelle du sang qui éclabousse tel une œuvre d’art. C’est comme si Burton avait trouvé le récit qui allait le mettre dans un état de « viscéralité » total. Le film est d'un romantisme sanguinolent (ce romantisme qui rime avec passion, donc douleur). Et Burton s'est bien amusé à représenter avec poésie le côté sanguin de la chose. Ce film fait mal tant il est porté par l'énergie désespérée du personnage si bien rendu par Johnny Depp.
J’ai été déçu par le Burton des dernières années (qui m’a semblé léthargique après le survolté et succulent Mars Attacks! [1996]). Quelle n’a pas été ma surprise de découvrir en Sweeney Todd le retour inespéré de l’auteur que j’adulais étant enfant. Et il est bon de voir Burton retrouver une partie de sa méchanceté. Surtout que jamais chez lui la mise en scène n’a été aussi créative. Les idées ingénieuses qu’on retrouve disséminés dans chaque plan m’ont subjugués, notamment tous ces jeux de miroir qui appuient avec force la névrose du personnage de Todd (ces plans magnifiques où il se mire dans le miroir de ses « amies » les lames de rasoir, à défaut de pouvoir se reconnaître dans le reflet de son appartement aux miroirs fissurés). La preuve qu’il n’ y a que dans la douleur que Burton arrive à se réveiller, comme si les couleurs vives et chatoyantes d’un Alice au Pays des Merveilles (2010) éloignaient l’auteur de ce qu’il avait véritablement envie de raconter émotionnellement. En ce sens, Sweeney Todd représente un must dans la filmographie du grand Tim.
LES AUTRES…
Pour finir, voici les quelques films que j’ai désespérément tenté de faire entrer dans le panthéon, et qui par faute de place n’ont pas pu s’y trouver. Ils méritent tout de même d’être nommés, et surtout d’être visionnés.
-Yi Yi (2000) de Edward Yang
-Two Lovers (2008) de James Gray
-Revolutionnary Road (2008) de Sam Mendes
-Ghost World (2001) de Terry Zwigoff
-Before Sunset (2004) de Richard Linklater
-Into the Wild (2007) de Sean Penn
-There Will Be Blood (2007) de Paul Thomas Anderson
-Children of Men (2006) de Alfonson Cuaron
-No Country for Old Man (2007) de Joel Coen
-The Man Who Wasn’t There (2001) de Joel Coen
-The Curious Case of Benjamin Button (2008) de David Fincher
-Letters from Iwo Jima (2006) de Clint Eastwood
-Mystic River (2003) de Clint Eastwood
-Star Wars: Episode III – The Revenge of the Sith (2005) de George Lucas
-The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) de Peter Jackson
-The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) de Peter Jackson
-Match Point (2005) de Woody Allen
-4 mois, 3 semaines et 2 jours (2007) de Cristian Mungiu
-Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) de Michel Gondry
-In the Bedroom (2001) de Todd Field
-La Vie Moderne (2008) de Raymond Despardon
-La Mémoire des Anges (2008) de Luc Bourdon
-Broken Flowers (2005) de Jim Jarmush
-The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007) de Andrew Dominik
-Cast Away (2000) de Robert Zemeckis
À votre tour

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F5%2F6%2F560579.jpg)